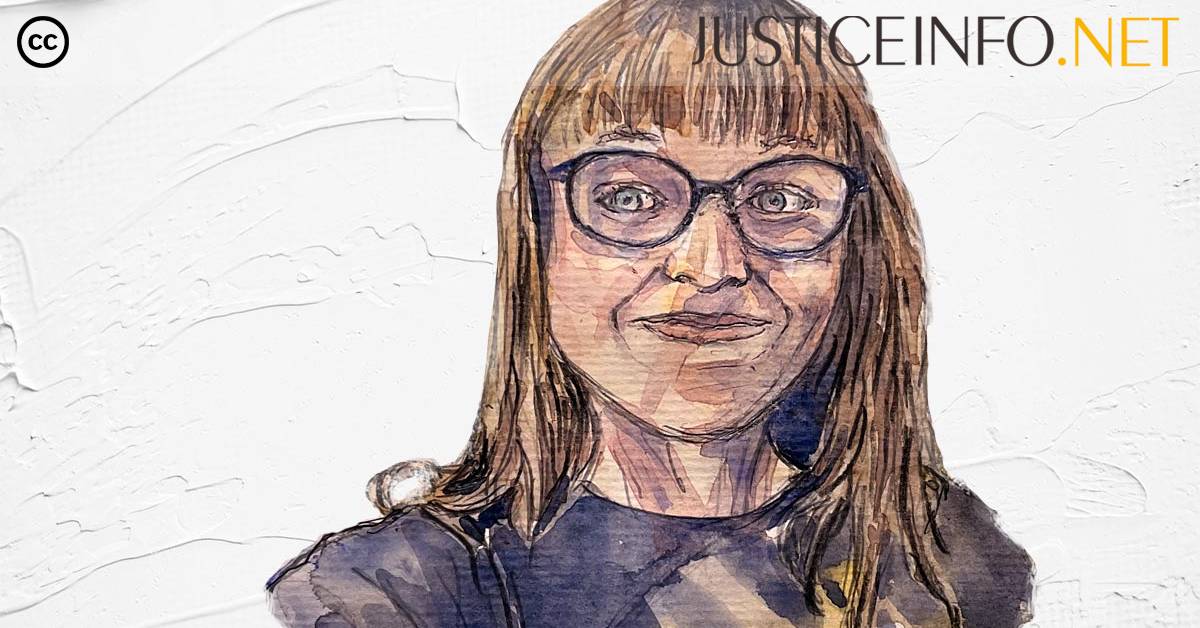
LES GRANDS ENTRETIENS JUSTICE INFO
Lucy Gaynor
Historienne, doctorante à l’université d’Amsterdam et au NIOD-Institut d’études sur la guerre, l’Holocauste et le génocide
Le 8 novembre 1994, moins de quatre mois après le génocide au Rwanda, les Nations unies créent le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR). En près de 30 ans de procès, comment ce tribunal a-t-il forgé son récit du génocide et comment a-t-il évolué ? L’historienne Lucy Gaynor termine une thèse sur le rôle des témoins experts dans la construction du récit historique du TPIR. Elle partage les réflexions issues de ses recherches avec Justice Info, où elle collabore régulièrement.
JUSTICE INFO : Environ 24 personnes que vous classez comme « témoins experts historiques » ont comparu devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) au cours de 26 années de procès. Elles ont témoigné dans 22 affaires différentes : 11 pour l’accusation, 12 pour la défense et un pour les deux. Vous avez sélectionné 5 de ces experts. Ils couvrent une période d’environ 17 ans et 8 procès. Pourriez-vous d’abord expliquer qui vous avez choisi et pourquoi ?
LUCY GAYNOR : Il est difficile d’identifier un témoin expert en histoire car la plupart d’entre eux ne sont pas des historiens. Les cinq personnes que j’ai choisies suivaient mon intérêt pour l’histoire au fil du temps. Je pense que ce qui est le plus intéressant et le plus unique à propos du TPIR, c’est le temps qu’il a pris, sans même inclure le Mécanisme [l’organe judiciaire qui a remplacé le TPIR après sa fermeture officielle en 2015]. Les personnes que j’ai choisies ont donc témoigné plus d’une fois sur plusieurs années. Je souhaitais également disposer d’un éventail d’experts de l’accusation et de la défense ayant témoigné dans différents types de procès. J’ai donc deux experts de l’accusation, Alison Des Forges et André Guichaoua, deux experts de la défense, Helmut Strizek et Bernard Lugan, et un qui a témoigné pour les deux, Filip Reyntjens.
J’y ai vu une tension à trois niveaux. Il s’agit finalement d’une tension entre l’histoire, le droit et le temps. Les experts en histoire sont tout à fait uniques. Si vous appelez un expert en balistique, par exemple, pour témoigner sur l’utilisation d’une certaine arme, je ne pense pas qu’un procureur ou un juge puisse imaginer qu’il ou elle connaît mieux le sujet. Lorsqu’un expert en histoire vient témoigner, il y a une conscience non dite que les avocats qui l’interrogent et les juges croient déjà savoir ou ont une compréhension implicite de ce qui s’est passé. Il y a donc une tension entre l’histoire et le droit, qui évolue au fur et à mesure que le tribunal progresse. Parfois, dans les premiers procès, chacun était heureux d’en entendre beaucoup sur l’histoire parce qu’ils comptaient en faire usage à leurs propres fins. Mais au fur et à mesure que le temps a passé et que l’histoire évoquée s’est davantage solidifiée et a sédimenté, tout le monde a commencé à être plus réticent à l’examiner parce que – que ce soit le procureur affirmant qu’il y a eu planification d’un génocide, la défense soutenant qu’il n’y a pas eu de génocide, ou des juges avec une connaissance uniquement fondée sur la lecture d’autres jugements – ils ont pensé : « Je comprends cela maintenant, alors passons à autre chose. » La tension est donc présente dès le départ, mais c’est une tension à trois dimensions.
Au fil du temps les experts qui ont contribué à construire cette première histoire ont été très frustrés de ne pas pouvoir en nuancer certaines parties.
Il s’agit d’une histoire sur le Rwanda qui s’est fondamentalement construite de la même manière que les condamnations ou les acquittements ont construit la jurisprudence. Mais la jurisprudence narrative a été produite en quelque sorte par accident. Lorsque Akayesu [le premier procès du TPIR, en 1997, a été celui de Jean-Paul Akayesu, un ancien maire rwandais] a été condamné, il s’est établi une compréhension de l’histoire rwandaise qui a alors fait partie du tribunal. Au fil du temps, cette compréhension a commencé à être considérée comme allant de soi et même les experts qui ont contribué à construire cette première histoire ont été très frustrés de ne pas pouvoir en nuancer certaines parties. Ainsi, avec le temps, tout le monde devient plus tendu et plus réservé lorsqu’il s’agit de parler de l’histoire, alors qu’en réalité, le tribunal avait besoin que tout le monde devienne plus nuancé dans son discours sur l’histoire.

Avez-vous des exemples ?
Le premier témoignage de Des Forges que j’ai étudié est celui d’Akayesu, en 1997, et le dernier celui de Zigiranyirazo, en 2005. Elle commence par être très nuancée et très ouverte. Puis, en 2002, lorsqu’elle témoigne au procès des Medias et au procès Bagosora, elle se sent tellement visée en tant que narratrice de cette histoire qu’elle devient très défensive à ce sujet et très ancrée dans ses propres idées. Et lorsqu’elle témoigne en 2005, elle parle beaucoup plus ouvertement des difficultés qu’il y a à dire quoi que ce soit avec une certitude totale en tant qu’historienne. Je ne pense pas qu’elle aurait jamais ouvert cette « boîte de Pandore », pour ainsi dire, dans le procès Bagosora [Théoneste Bagosora, ancien directeur de cabinet au ministère de la Défense, est considéré comme l’accusé le plus important devant le TPIR] parce que tout était tellement disputé. On passe d’une position presque très optimiste en termes de narration de l’histoire à une position très défensive, puis à une sorte de résignation face à ces frustrations qu’elle n’a manifestement pas réussi à résoudre au cours des procès.
Il y a tellement d’autres choses qui se passent en coulisses. Les jugements ne racontent qu’une partie de l’histoire sur le plan de la compréhension historique.
Ainsi, au début, le tribunal est très ouvert à l’élaboration d’un récit parce qu’il n’en a pas, et les experts sont plus préoccupés par l’établissement d’un récit de base. Et des années plus tard, le tribunal a un intérêt beaucoup plus étroit pour l’histoire et les experts veulent être plus nuancés et plus complexes ?
Oui, et ils veulent élargir leur propos. Si l’on s’en tient aux seuls jugements, c’est une histoire qui fait autorité, mais on ne se rend pas vraiment compte de tout ce qui n’a jamais été inclus dans les jugements ou les actes d’accusation parce que ce n’était pas pertinent. Il y a tellement d’autres choses qui se passent en coulisses. Les jugements ne racontent qu’une partie de l’histoire sur le plan de la compréhension historique.
Est-ce aussi dû au fait que le TPIR a commencé par des procès « mineurs » alors que dans les années 2000 il se tourne vers des acteurs centraux où l’histoire compte et a davantage d’importance pour la culpabilité ou l’innocence des accusés ?
C’est un facteur moins important que je ne le pensais à première vue. Filip Reyntjens le dit d’ailleurs à haute voix dans le procès Bagosora, lorsqu’il se tourne vers les juges et déclare : « Cela aurait dû être le premier procès. » En partie, il a raison ; et en partie, il surestime la capacité d’un seul procès à établir une histoire solide. La partie la moins évidente du problème est le fait que, dans un tribunal comme le TPIR, le récit de l’accusation se construit au fur et à mesure, alors que le récit de la défense commence et se termine essentiellement au cours du même procès : il est plus circonscrit. Les avocats d’Akayesu, au final, ne cherchent qu’à s’assurer qu’Akayesu soit acquitté des chefs d’accusation spécifiques sur les violences dans la commune de Taba. Si le procès Bagosora avait été le premier, je pense que le problème aurait été le même. On aurait toujours cette différence entre l’accusation qui a tout son temps pour construire un récit et la défense qui n’a que son procès individuel sur lequel se concentrer.
L’ensemble de la dynamique du procès est tellement interactive que personne n’a vraiment le contrôle sur le récit qui en sort. Tout dépend du type de questions posées, de l’humeur de l’expert, de l’intérêt des juges à dialoguer avec l’expert.
Le jugement Bagosora se distingue par la tentative de narration la plus nuancée et la plus complexe que le TPIR ait jamais permise, y compris sur le sujet sensible de la planification du génocide. Pourtant, il n’a jamais servi de nouveau récit, de nouvelle référence. Personne ne s’en souvient. Et il a été immédiatement effacé par la chambre d’appel. C’est comme s’il ne pouvait pas devenir un récit dominant…
Je pense que ce qui est le plus frustrant, c’est qu’il est difficile de déterminer ce qui pourrait être fait différemment. Ce que mes recherches m’ont montré, c’est à quel point l’ensemble de la dynamique du procès est tellement interactive que personne n’a vraiment le contrôle sur le récit qui en sort. Tout dépend du type de questions posées, de l’humeur de l’expert, de l’intérêt des juges à dialoguer avec l’expert. Si le jugement Bagosora avait été le premier, je ne sais pas s’il aurait eu un impact différent.
Quatre de mes cinq experts ont témoigné dans le procès Bagosora – Des Forges, Reyntjens, Strizek et Lugan. Tous les quatre ont été plus affirmatifs dans leur récit qu’ils ne l’avaient été dans les procès précédents. Des Forges a été la plus affirmative : voici les preuves de la planification et voici mon interprétation des preuves. Et pourtant, les juges se sont montrés nuancés, ce qui n’était peut-être pas le cas auparavant. Je ne suis donc pas sûre qu’il y ait un ordre correct pour mener ces procès.

Les experts eux-mêmes, je pense sans vraiment le vouloir, ont pratiquement établi qu’ils étaient parmi les seuls à pouvoir expliquer ce qui était vraiment dit.
Je pense qu’ils l’ont façonné de bout en bout. Même lorsque l’accusation a été confrontée à des défis tels que l’acquittement sur la conspiration en vue de commettre un génocide, [le récit] a toujours été construit à partir du même point de départ. Ce qui est si spécifique au contexte rwandais, c’est l’insistance de tous les experts sur le fait qu’il y a toujours une autre couche d’interprétation face à ce qui paraît évident au départ. Des Forges et Guichaoua parle de double langage. Les experts eux-mêmes, je pense sans vraiment le vouloir, ont pratiquement établi qu’ils étaient parmi les seuls à pouvoir expliquer ce qui était vraiment dit. Si je vous parle de l’histoire d’un pays et que je vous dis que les hommes politiques ont toujours dit ceci mais qu’ils voulaient dire cela et que vous ne pouvez comprendre cela que si vous comprenez le contexte, alors bien sûr, en tant que procureur, vous allez vous adresser à quelqu’un qui, selon vous, comprend le contexte. La nature de l’histoire rwandaise fait que l’accusation dépendait davantage des experts historiques, par rapport au tribunal de Yougoslavie, par exemple, où l’histoire était beaucoup plus scientifique concernant les mouvements politiques, la formation des partis politiques et les discours politiques. Au Rwanda, tout cela était également abordé, mais il s’agissait de comprendre ce qu’ils « voulaient vraiment dire » lorsqu’ils ont dit ou fait ceci ou cela – et cela a permis aux experts d’avoir une énorme influence sur le récit de l’accusation.
Au moins deux d’entre eux, Des Forges et Guichaoua, étaient presque intégrés au bureau du procureur. Ils ont joué un rôle dans les enquêtes en plus d’être appelés à témoigner en tant qu’experts. Les voyez-vous gérer cette tension entre être au service de la vérité historique et servir les objectifs du tribunal ?
Je l’ai vu de deux manières. D’une part, d’une manière très existentielle qui, je l’imagine, a été difficile pour eux. D’autre part, dans les banalités même du tribunal. Par exemple, lors du procès Gouvernement II, l’accusation demande aux juges s’ils peuvent autoriser Des Forges à parler aux membres d’autres équipes du procureur, parce qu’elle est alors impliquée dans de nombreux procès. La défense émet de nombreuses objections et la discussion se poursuit sur plusieurs pages de témoignage où, à un moment donné, les juges se demandent avec qui Des Forges peut ou ne peut pas dîner pendant qu’elle est à Arusha. À la fin, tout le monde rit presque de la folie de la situation.
Des Forges se débat très clairement avec le fait qu’une partie de son travail consiste à rechercher activement la justice tandis que son travail académique cherche à raconter les atrocités qui ont conduit à cette justice d’une manière plus objective.
Dans le procès Zigiranyirazo, même les juges reconnaissent cette tension entre vérité historique et servir le tribunal. Ils reconnaissent la double objection de la défense à l’égard de Des Forges en tant qu’expert : premièrement, son expertise est-elle pertinente ? Deuxièmement, même si elle est pertinente, est-elle à ce point intégrée dans le bureau du procureur que son témoignage est irrévocablement entaché ? Dans ce contre-interrogatoire, Des Forges se décrit comme une personne ressource pour la vérité et la justice. Elle se débat très clairement avec le fait qu’une partie de son travail consiste à rechercher activement la justice tandis que son travail académique cherche à raconter les atrocités qui ont conduit à cette justice d’une manière plus objective.
Les experts essaient par ailleurs de marcher sur une corde raide. Des Forges est interrogée à plusieurs reprises sur le mot génocide ou sur l’existence d’une guerre et elle répond : « Je ne suis pas juriste ». Guichaoua dit régulièrement : « Je ne suis pas historien ».
Au fur et à mesure que les procès avancent, il apparaît clairement qu’ils ne sont là que pour donner les réponses que les juristes en charge de l’interrogatoire veulent qu’ils donnent.
Des Forges est décédée dans un accident d’avion en 2009 ; Reyntjens n’a plus été appelé assez tôt en raison de ses opinions politiques critiques sur le gouvernement rwandais après le génocide ; Guichaoua est resté jusqu’à la fin mais a souvent été en conflit avec le bureau du procureur. Voyez-vous l’évolution de leurs relations avec un tribunal qu’ils ont souhaité et soutenu à l’origine et qui, peu à peu, a semblé les mettre à l’écart ?
Je pense que oui. Même avant qu’ils ne soient mis à l’écart, on peut percevoir une frustration face au manque d’espace dont ils disposent pour prendre le contrôle d’un quelconque récit, à la diminution de leur rôle en tant que participants actifs. Au fur et à mesure que les procès avancent, il apparaît clairement qu’ils ne sont là que pour donner les réponses que les juristes en charge de l’interrogatoire veulent qu’ils donnent. Lorsque Reyntjens témoigne pour la défense dans le procès de Butare, le procureur ne lui pose pas une seule question en contre-interrogatoire. On pourrait penser à une situation de rêve : vous êtes face à un témoin que vous connaissiez très bien et qui a changé d’avis. A mes yeux, le fait que le procureur ne lui ait posé aucune question montre que l’attitude à l’égard des experts consiste à les utiliser dans un but précis et c’est tout.
Vous décrivez un rétrécissement du champ que les acteurs du tribunal – avocats, juges et experts – laissent à l’incertitude ou à la nuance, alors que les connaissances scientifiques sur le génocide se sont développées. Le récit historique suit-il une évolution linéaire ou a-t-il une trajectoire fluctuante ?
Il fluctue complètement, et c’est ce qui est si difficile à comprendre au sujet du TPIR. Vous avez ce récit d’autorité qui émerge dans chaque jugement. Ce récit est solidifié, presque sédimenté. Mais en réalité, les fondements de ce récit sont tellement fragiles, tellement contestés, tellement dépendants de tant de facteurs différents. Je me suis lancée dans cette recherche en pensant : bien, il y a un récit simpliste au début et quand on arrive au jugement de Bagosora, c’est plus nuancé. Mais c’est bien plus compliqué que cela, car c’est tellement imprévisible.
Il y a probablement différents groupes ou publics sur le TPIR et chacun en a tiré un récit. Chacun de ces groupes a une compréhension différente de la manière dont le TPIR a traité l’histoire.
Et finalement, y a-t-il un récit dont tout le monde s’accorde à dire qu’il est celui qui est issu du TPIR ?
Je pense qu’il y a probablement différents groupes ou publics sur le TPIR et que chacun en a tiré un récit. La communauté de la justice internationale énonce un récit très clair non seulement sur la validité des verdicts, mais aussi sur une compréhension globale de ce qui s’est passé au Rwanda en 1994. Il existe une interprétation rwandaise de ce qui s’est passé en 1994. Il existe aussi une interprétation potentielle qui tente d’apporter de la complexité et qui peut parfois friser le négationnisme. Chacun de ces groupes a une compréhension différente de la manière dont le TPIR a traité l’histoire. Et tous y trouvent potentiellement de l’eau à leur moulin. Ils peuvent tous évoquer des événements survenus lors des procès et dire que telle ou telle chose a été débattue.
Il y a beaucoup plus de nuances dans les procès eux-mêmes. Le problème est le décalage entre la complexité du procès et l’aseptisation du jugement. C’est là qu’apparaît le décalage entre la façon dont les gens comprennent l’histoire.
On se retrouve avec ceci : oui, nous sommes d’accord avec les experts pour dire qu’il y a eu une planification, nous sommes d’accord pour dire que c’était quelque temps avant 1994, mais nous ne savons pas nécessairement lequel d’entre eux a raison sur le moment où cela a commencé, comment cela a commencé, et qui l’a commencé.
Prenons l’exemple de ce qui est encore si controversé et contesté : la question de la planification du génocide. Il y a ceux qui disent que, bien sûr, il a été planifié et qu’il fallait qu’il le soit sinon on pourrait avoir un problème pour le qualifier de génocide. D’autres disent qu’il n’a pas été planifié, certains voulant en conclure qu’il ne s’agit donc pas d’un génocide. Et d’autres qui disent : ce n’est pas la question, c’est une histoire singulière avec ses dynamiques spécifiques qui ne doivent pas être comprises à travers le prisme du nazisme. Avez-vous identifié le « méta-récit » du TPIR sur la planification du génocide ?
Quand on combine le récit historique et le récit juridique du TPIR, on aboutit à un « génocide de Schrödinger » [selon une expérience imaginée par Schrödinger, deux réalités apparemment incompatibles peuvent se superposer] : il y a eu génocide, il a été planifié, mais pas de la manière ou par les personnes que nous pensions qu’il avait été planifié. Pour moi, c’est l’un des aspects les plus compliqués de la planification. Le jugement du procès Bagosora lui-même en parle : les experts de l’accusation disent tous que le génocide a été planifié, mais ils donnent tous des dates différentes à partir desquelles la planification a commencé. Des Forges affirme que le génocide a été planifié à partir de la fin 1993 ; Reyntjens est plus sceptique, il affirme qu’il ne s’agissait pas d’une planification, mais plutôt d’un processus progressif qui a commencé en 1990. Il ajoute ensuite que, s’il devait donner une date, il dirait 1992. Vous avez donc deux experts différents qui donnent trois dates différentes pour le début de la planification, ce qui me semble tout à fait possible si vous pensez en termes de méta-récits historiques. Mais lorsque vous essayez de les superposer à l’impératif juridique d’établir une intention afin de condamner quelqu’un pour ce crime, ils ne peuvent pas à travailler avec cela. Et on se retrouve avec ceci : oui, nous sommes d’accord avec les experts pour dire qu’il y a eu une planification, nous sommes d’accord pour dire que c’était quelque temps avant 1994, mais nous ne savons pas nécessairement lequel d’entre eux a raison sur le moment où cela a commencé, comment cela a commencé, et qui l’a commencé.

Avez-vous l’impression que la cour se sentait frustrée à ce sujet ?
Je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles les juges n’aiment pas les historiens. Parce que les historiens disent communément des choses comme : « Oh, cela aurait pu être en 1990 ou en 1992 ». Mais ce n’est pas ce que veut le droit. Le droit a une fonction qui n’a pas besoin ou ne veut pas de cela. Au moment du procès Bagosora, tout le monde est conscient de la complexité des faits. Chile Eboe-Osuji [le procureur en charge du procès Bagosora] ouvre le procès avec l’introduction la plus spectaculaire du plan [génocidaire]. Il présente un document très compliqué intitulé « la toile enchevêtrée de la conspiration » qu’il montre à toute la cour. Il cite ensuite Shakespeare, et la citation qu’il utilise est la suivante : « Oh la toile enchevêtrée que nous tissons/Quand nous cherchons d’abord à tromper ». Il ne s’agit pas d’une citation de Shakespeare, mais d’un poème de l’historien écossais Walter Scott. Pour moi, cela résume tout : vous essayez de montrer cette conspiration shakespearienne, presque médiévale, en vue d’un génocide, et finalement c’est quelque chose de complètement différent. Cela ne veut pas dire qu’il ne s’agit pas d’une conspiration, c’est juste différent.
Et le récit qu’il a présenté dans ce qui était sans doute le procès le plus important du TPIR a été largement démantelé dans le jugement. Il n’a pas résisté à l’épreuve des faits et des preuves.
Non. Et on peut voir la frustration dans ses interactions avec Des Forges au cours de ce procès. Les objections de la défense sont si nombreuses au début du procès qu’un jour, Des Forges n’a même pas pris la parole. Elle est presque devenue une observatrice de son propre témoignage. La seule fois où elle parle, c’est lorsque le juge Lloyd Williams lui demande : « Pour combien de temps êtes-vous là ? » Eboe-Osuji se met à essayer d’avancer au galop dans son récit et Des Forges se désespère à essayer de simplifier ce récit, même si elle a affaire à un procureur « amical ». Lui essaie de passer à autre chose parce qu’il a un objectif juridique en tête et elle prend 3 ou 4 minutes pour débattre avec lui pour essayer d’affirmer l’importance historique de certains détails. Pour moi, cela résume la tension.
Il est difficile d’évaluer la qualité réelle des interprétations d’un expert de la défense.
Oui, je pense que le rôle des experts de la défense, quel que soit l’expert, est beaucoup plus difficile que je ne l’avais d’abord imaginé. Ces experts de la défense sont appelés – en particulier pour Lugan et Strizek – avec comme fonction première de démystifier Des Forges. Strizek n’est pas là pour parler de son point de vue sur le génocide rwandais, il est là pour parler du point de vue de Des Forges. Et elle n’est pas là. Il a donc une sorte de conversation décousue avec Des Forges à travers les questions de la défense et du procureur. Il est ainsi difficile d’évaluer la qualité réelle des interprétations d’un expert de la défense.
J’ai parlé à un avocat de la défense dans l’un des procès thématiques, je lui ai dit que je m’intéressais au rôle des experts historiques – je ne pense pas qu’il savait que j’étais historienne – et il m’a répondu : « Qu’est-ce qu’un expert historique ? Cela n’existe pas ! » Il ne s’intéressait pas à l’expertise historique, mais au rôle que l’expert pouvait jouer pour démystifier l’accusation. C’est une stratégie complètement différente, mais c’est aussi extrêmement difficile pour l’expert. Il doit être un expert de l’histoire et un expert de l’expert.
Il y a cette idée que ces experts sont irréprochables parce qu’ils viennent de l’étranger. Mais qui vous considère comme irréprochable ?
Tous les experts entendus n’étaient pas rwandais. L’ensemble du récit est façonné par des étrangers. Un commentaire à ce sujet ?
Ce que l’on constate dans les tribunaux internationaux en général, c’est que souvent les universitaires – en particulier ceux du Nord – affirment que plus un expert vient de loin, mieux c’est. Il y a cette idée que ces experts sont irréprochables parce qu’ils viennent de l’étranger. Mais qui vous considère comme irréprochable ? Les personnes qui écoutent – qui, au TPIR, étaient aussi des non-Rwandais. L’objectif de l’expert est de raconter l’histoire à un très petit sous-ensemble de personnes – les juges – qui rédigent ensuite des jugements qui doivent être considérés comme l’histoire du Rwanda, ou du moins du génocide, et tout le monde va être d’accord avec cela. Si on décide que tel est le but, alors toute l’entreprise est vouée à l’échec dès le départ. Car il faut reconnaître cette disjonction. Reconnaître la distance qui existe entre celui qui raconte l’histoire, celui qui l’écoute, celui qui l’écrit et celui qui doit recevoir cette histoire. Ce sont potentiellement quatre groupes de personnes complètement différents. Cela ne change pas nécessairement la façon dont le tribunal fonctionne, mais cela change la façon dont on considère aujourd’hui le succès ou l’échec du tribunal, car selon la personne à qui vous le demandez, le tribunal a soit fait un très bon travail sur le plan de l’histoire, soit un très mauvais travail, et très peu de gens entre les deux.
Pensez-vous que la même dynamique s’observe à propos du récit historique devant des tribunaux nationaux utilisant la compétence universelle, comme pour les Rwandais jugés devant la justice française ou belge, un Libérien devant la justice suisse, ou un Syrien dans un tribunal allemand ?
Je pense que, même au sein de la compétence universelle, cela diffère selon le système juridique. Et cela indique à quel point ces récits dépendent des interactions dans la salle d’audience. Il est arrivé aux Pays-Bas que les juges demandent à bénéficier d’une conférence historique avant un procès, séparément de celui-ci, parce que celle-ci n’est pas nécessairement considérée comme pertinente pour les charges individuelles, mais jugée utile pour les juges afin de replacer les accusations dans leur contexte.
Le TPIR, même lorsqu’il déclare ne pas vouloir écrire l’histoire du Rwanda, a duré si longtemps et jugé tant de personnes qu’il a fini par assumer ce rôle. Dans les procès de compétence universelle, il n’y a pas cette attente.
Ce qui, dans un autre système juridique, serait considéré comme une base pour révoquer les juges…
J’imagine que oui, ou du moins que l’expert qui a donné la conférence serait contesté pour ses préjugés ou ses interprétations. En ce qui concerne la compétence universelle, elle est si sporadique et si dispersée que les avocats, les juges ou les experts ne sont pas soumis à la même pression pour rédiger ce récit. C’est beaucoup plus facile parce que la charge historique n’est pas nécessairement équivalente à celle de ces grands tribunaux qui se sont donné de remplir toutes ces fonctions différentes. Le TPIR, même lorsqu’il déclare ne pas vouloir écrire l’histoire du Rwanda, a duré si longtemps et jugé tant de personnes qu’il a fini par assumer ce rôle. Dans les procès de compétence universelle, il n’y a pas cette attente.
Que concluez-vous sur l’utilisation ou non d’historiens ou d’experts historiques dans ces procès ? Devrions-nous nous en passer ou devons-nous accepter les ambiguïtés et les contradictions inhérentes que vous venez d’exposer ?
J’ai beaucoup fluctué. Pendant longtemps, ma réponse personnelle a été que je trouvais ces experts très importants… et que je ne le ferais pour rien au monde. Mais si je ne le fais pas, quelqu’un d’autre le fera si on le lui demande. Je serais intéressée de savoir combien d’experts ont dit non avant que ceux qui ont fini par témoigner n’aient dit oui. La conclusion à laquelle je suis parvenue est qu’une approche plus holistique consiste à ce que toutes les personnes impliquées, et pas seulement les avocats, soient plus conscientes du fait qu’aucun d’entre eux n’a de contrôle sur le récit qui émerge de la salle d’audience, et donc à accepter davantage les nuances, les défis, les incertitudes qui vont émerger dans le témoignage d’un expert en histoire. Ils sont tellement inévitables que si vous ne les acceptez pas, l’histoire que vous essayez d’écrire s’en trouvera complètement minée.
Robert Donia, qui a témoigné à plusieurs reprises devant le Tribunal de l’Onu pour l’ex-Yougoslavie, de la même manière que Des Forges l’a fait devant le TPIR, disait toujours que les mots les plus précieux qu’un témoin expert pouvait prononcer étaient les suivants : je ne sais pas. Mais souvent, lorsqu’un expert dit « je ne sais pas », il est tout à fait conscient que quelqu’un tentera de saper tout ce qu’il dira en se basant sur le fait qu’il ne sait pas cette seule chose. Ce que j’ai vraiment observé au cours des procès, c’est qu’il est important pour les experts d’être moins sur la défensive en ce qui concerne leur expertise – je dis cela en toute tranquillité, assise dans une salle où personne ne me contre-interroge devant cinq accusés et dix avocats…
il faut comprendre que lorsque l’histoire est introduite dans ce système accusatoire, elle est déformée
C’est également le système accusatoire qui permet cette attitude défensive, car il s’agit d’un exercice intrinsèquement hostile, ce qui n’est pas le cas d’un système plus inquisitoire. Il y règne une telle compétition qu’il s’agit d’un jeu à somme nulle, alors qu’en réalité, « je ne sais pas » et « j’ai eu tort » sont deux choses différentes. Les juges peuvent peut-être aussi en tirer des leçons : il faut comprendre que lorsque l’histoire est introduite dans ce système accusatoire, elle est déformée de telle manière que toute personne qui la lit doit le prendre en compte lorsqu’elle doit déterminer ce qui est utilisable et ce qui ne l’est pas.
Finalement, existe-t-il un récit historique cohérent issu de près de trois décennies de procès au TPIR ?
Je souris parce que c’est la raison pour laquelle les avocats détestent les historiens : ma réponse est que cela dépend de la question que vous posez. Le problème d’un tribunal qui est une ressource pour l’histoire est qu’il a une telle autorité que l’utiliser comme ressource signifie inévitablement de vous voir poussée à argumenter en sa faveur ou contre lui. Vous êtes alors prise au piège du système accusatoire, car vous pensez au récit et votre instinct vous pousse à dire : était-ce juste ou était-ce faux ? Il est tout aussi facile de l’utiliser comme une ressource que de se laisser entraîner dans le jeu à somme nulle qu’est le système juridique accusatoire. Et bien sûr, il n’existe pas qu’un seul récit historique, il peut y avoir cinquante récits différents pour chaque accusé, pour chaque année après 1990.
Recommandé par la rédaction

Kabuga et le fantôme d’une justice à venir
 LUCY GAYNOR
LUCY GAYNOR
Lucy J. Gaynor est doctorante à l’université d’Amsterdam et au NIOD-Institut d’études sur la guerre, l’Holocauste et le génocide. Son doctorat, provisoirement intitulé « The Past is Never Dead : Historical Narratives in International Criminal Trials » (Le passé n’est jamais mort : récits historiques dans les procès pénaux internationaux), examine la narration de l’histoire par les témoins experts dans les salles d’audience internationales. En utilisant le Tribunal pénal international pour le Rwanda comme étude de cas, le projet prend un échantillon de 5 experts et de 8 procès pour réfléchir à l’impact du passage du temps sur les tentatives juridiques et historiques conjointes, coopératives ou disputées, pour raconter les atrocités de masse qui ont eu lieu au Rwanda en 1994.



















